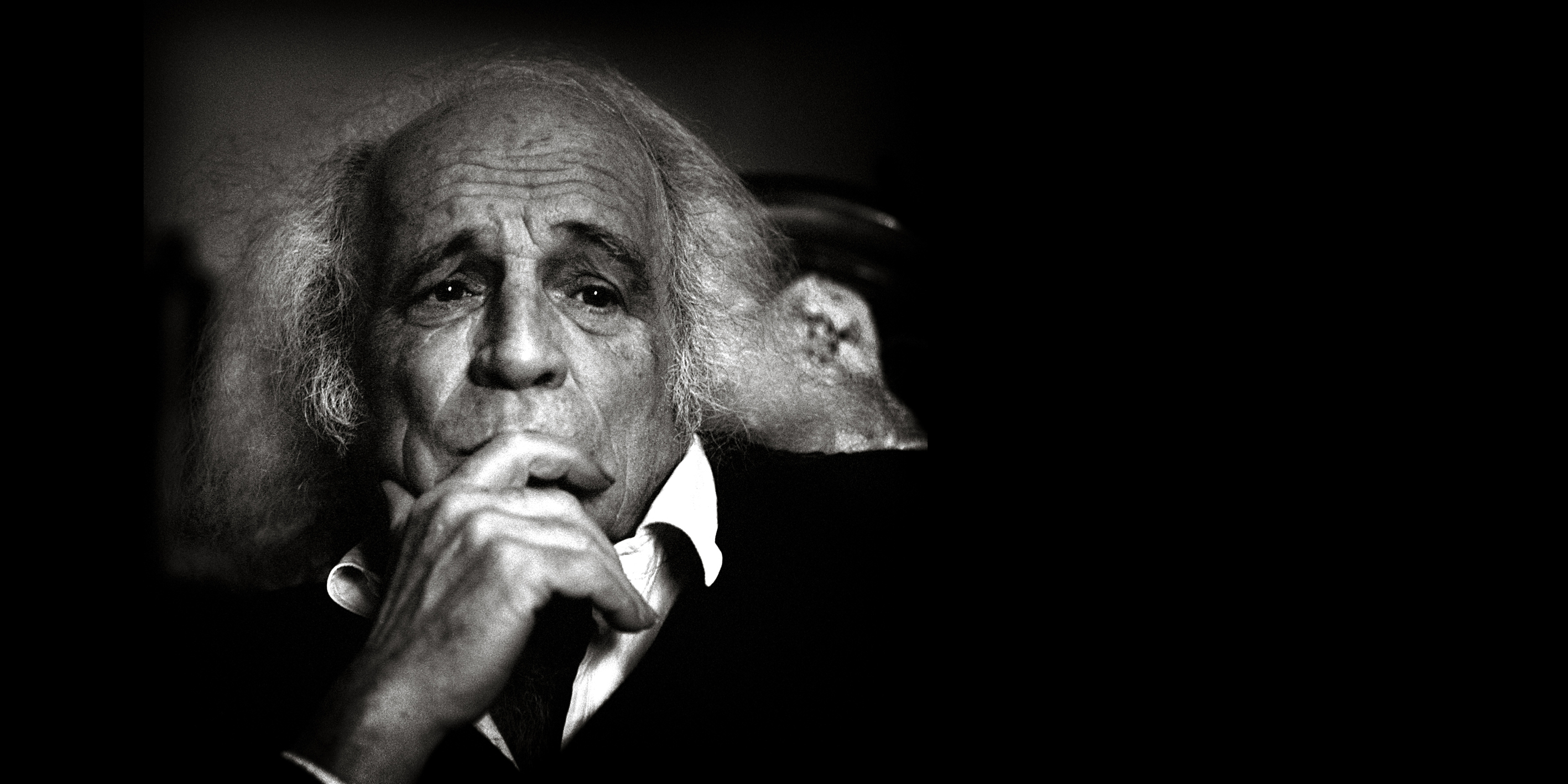La plus belle chanson du monde, c’est Le chant du fou. Il y est question d’une vérité que tu cherches par-delà l’espace. D’une vérité au bout des doigts, que tu éclaires d’une lampe entre les mâchoires. D’un fou qui meurt de désespoir. Le fou effleure la vérité, la lumière le fou déflore, il est fou de la côtoyer et meurt de cette proximité malgré le rempart de sa folie. Malgré l’apaisement de son chant. Le chant du fou s’élève entre les tombes. Les arbres du cimetière frémissent de frôler cette vérité de cyprès. Même mort, le fou chante encore, un nombre premier le fou chante, pour couvrir les inepties qu’on profère autour de lui à longueur de débit. Les hochements de tête sur son corps encore chaud. Le chant du fou, c’est sa manière de résister à la pollution, de résister à la résignation, c’est sa manière de s’élever au-dessus du charnier des idées à l’agonie, de planer sur les détritus de la pensée prémâchée, de prendre le recul nécessaire pour conserver sa fragile et précieuse dose de folie et l’emporter dans l’au-delà.
Un autre fou sort de son trou et vient respirer la lumière. Il s’en gorge immodérément, les poumons plein de vérité, il expire son rire dans un chant trop bruyant, ivre d’impuissance et d’avoir trop compris, d’un seul coup il rit, tandis qu’autour de lui, chacun poursuit son minutieux travail de sape et d’anéantissement. Demain tu verras tous ces petits alchimistes pulvériser un continent.
Le fou chante gratuitement. Il n’espère ni un sursaut des consciences, ni attirer l’attention. Il se contente de cueillir des pensées délicates dans le tumulte de la déraison, d’arroser les pensées qui germent sur son balcon. De les arroser en chanson. Il nourrit ses mythes de compagnie et dialogue par-delà les siècles, puisque le sien l’étiquette. S’ébroue pour secouer les épithètes qu’on lui colle à la peau. Son grand plaisir est de déjouer les pronostics, de démentir les diagnostics, sans jamais sacrifier sa folie sur l’autel de la science. Il chante son désaccord de sol, d’un chant qui ne se laisse inscrire sur aucune partition.
Le fou chante pour couvrir le tumulte de son désarroi. Il chante autant de fois qu’il faut pour s’apaiser. Et son chant insoutenable de vérité refoulée se perd dans la frénésie d’un monde enchaîné à sa propre ivresse. L’alcool se fige dans ton verre sans pouvoir déchirer ta tristesse. De son chant le son s’éteint sans tympan percuter, pauvre champ de pharyngales en plein vol fauchées.
Pris dans le naufrage collectif, le fou s’émeut d’un détail, d’une poussière promesse de renouveau. Cet artisan de l’impalpable a mis l’espoir en berne et le chant en avant. Dix-sept fois ce matin, pour dix-sept riens, il a chanté et sa voix comme un sanglot de beauté m’appelle à douter de tout, sauf du fou, écrin de vérité. Prisonnière des convenances, j’envie sa folie d’affranchi et pour m’entraîner je chante, à tue-tête, j’expire le chant comme d’autres le poison, me laisse insuffler la liberté inspirée par le fou, l’air de rien, dans un souffle, et sans cesse remets l’ouvrage sur le métier, dix-sept fois, moi aussi, ce matin, j’ai chanté.
Sabine Dormond