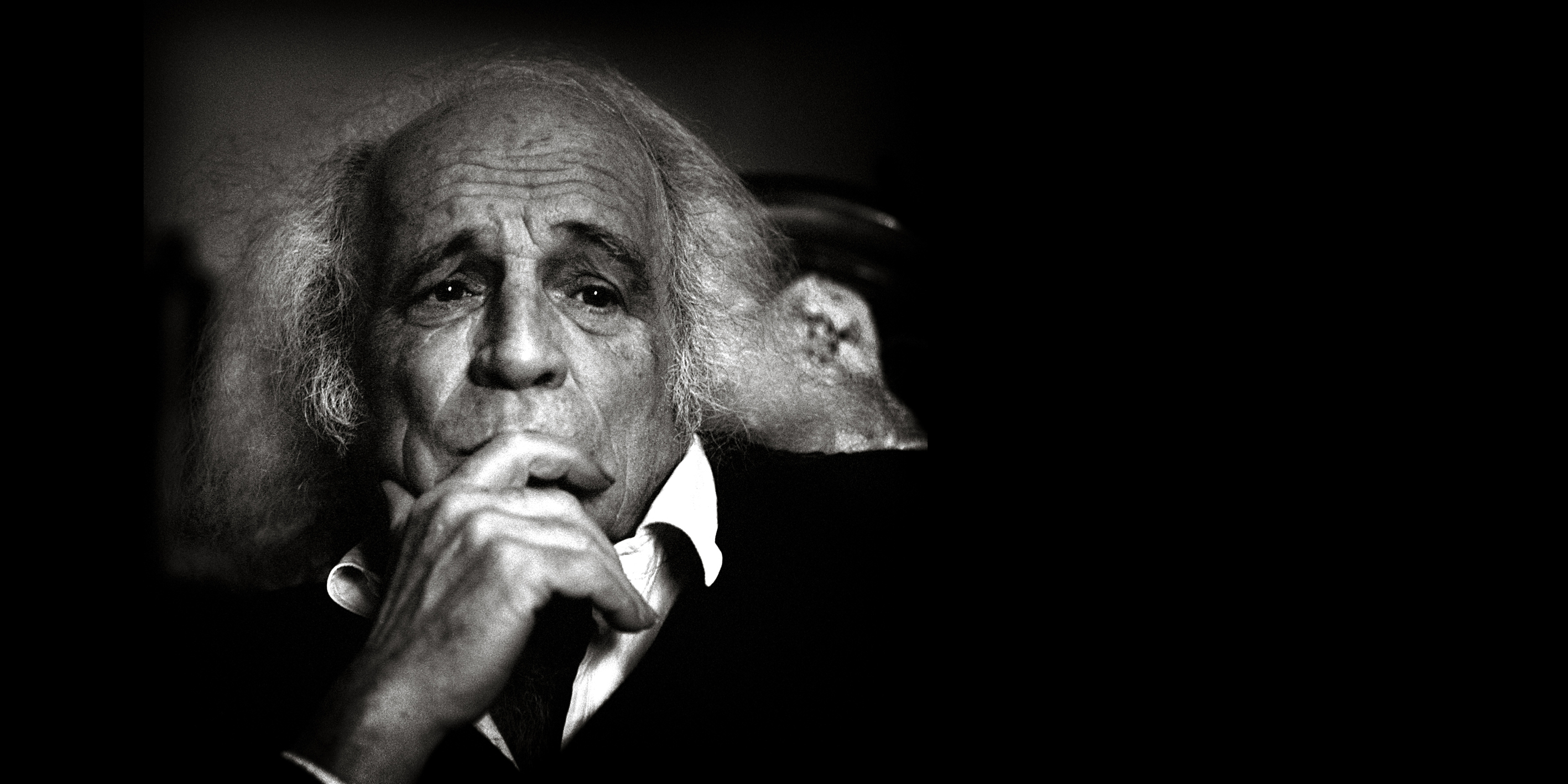Journée tiède et lumineuse d’octobre, comme un sursis avant la longue nuit.
Malgré la peine qui m’étreint, qui m’enveloppe comme un manteau diaphane et impalpable, comme une seconde peau, je roule, libre et presque heureuse, sur une autoroute à peu près déserte, vers toi. Il y a moins d’une semaine, j’ai fait le même chemin sous le vent en rafale et la nuit qui giflait mon pare-prise, pleurant toutes ses larmes presque verticales, et moi psalmodiant presque : Pourvu que j’arrive à temps.
J’entends les mélodies grises
Et toute ces voix qui disent:
« Ils viendront plus. »
J’entends les fontaines de pleurs.
120km plus loin, tu étais calme, souriante, détendue sur ton lit trop blanc, tous étaient déjà là, et la soirée fut douce, une soirée à cinq, intime, tendre, et où je racontais des blagues – c’était mon rôle après tout, raconter des blagues, je faisais ça très bien autrefois. Après l’embollie l’embellie, l’oxygène qui te pétait la tête, toi qui ne buvais même pas un verre de vin le dimanche, mais ça t’allait bien, cette euphorie, ce lâcher-prise; et tu m’as dit : Frédie, on croirait une chanson d’Aznavour… elle va mourir la mama. Ta façon de nous dire : je sais, et j’accepte. Alors on a accepté aussi.
Les médecins ont dit une semaine au plus, sans doute moins. Le potassium, ça te fait exploser le cœur pire qu’un chagrin d’amour, mais ton cœur à toi c’est le cœur le plus fort, le plus résistant, de mémoire de médecin et d’enfant. J’ai une semaine toute à nous, pour te dire au revoir, tenir ta main chaude, parler pour deux parce que tu préfères te taire et sourire; te regarder lentement t’éteindre en te lisant le nouvel obs, les critiques de films que tu ne verras pas, de livres que tu ne liras pas, mais tu t’en fous déjà. J’espère.
J’ai l’impression d’avoir une cible,
Émerger du brouillard
Je roule vers toi dans l’été indien soudain jailli d’ailleurs et pour combien de temps, j’ai mis un CD dans le lecteur de la micra, et je chantonne. Dans une heure je serai avec toi. J’ai tout mon temps. Ma fille est partie en classe verte, elle a cinq jours pour apprendre à nourrir les lapins, à éplucher, grossièrement, les pommes de terre, et à me quitter un peu. Moi j’ai cinq jours pour apprendre à te quitter vraiment.
La chanson, je la repasse en boucle.
Il me reste un couplet d’Imagine
Qui m’emmène ailleurs…
plus tard, mais je ne le sais pas encore, quand le chagrin creusera dans mon plexus un puits que rien ne saurait combler, et que, recroquevillée dans un coin de ma chambre, toute lampe éteinte, je gémirai comme une bête, les écouteurs fichés dans les oreilles, je me repasserai, en boucle, cette chanson, et peu à peu je déplierai mes jambes, j’essuierai la morve sur mon visage, et je rallumerai la lumière.
Juste des jours meilleurs…
Après tout, c’est ce que tu aurais voulu pour moi.
Fred Bocquet
https://www.youtube.com/watch?v=j6NhNgYcR7Q