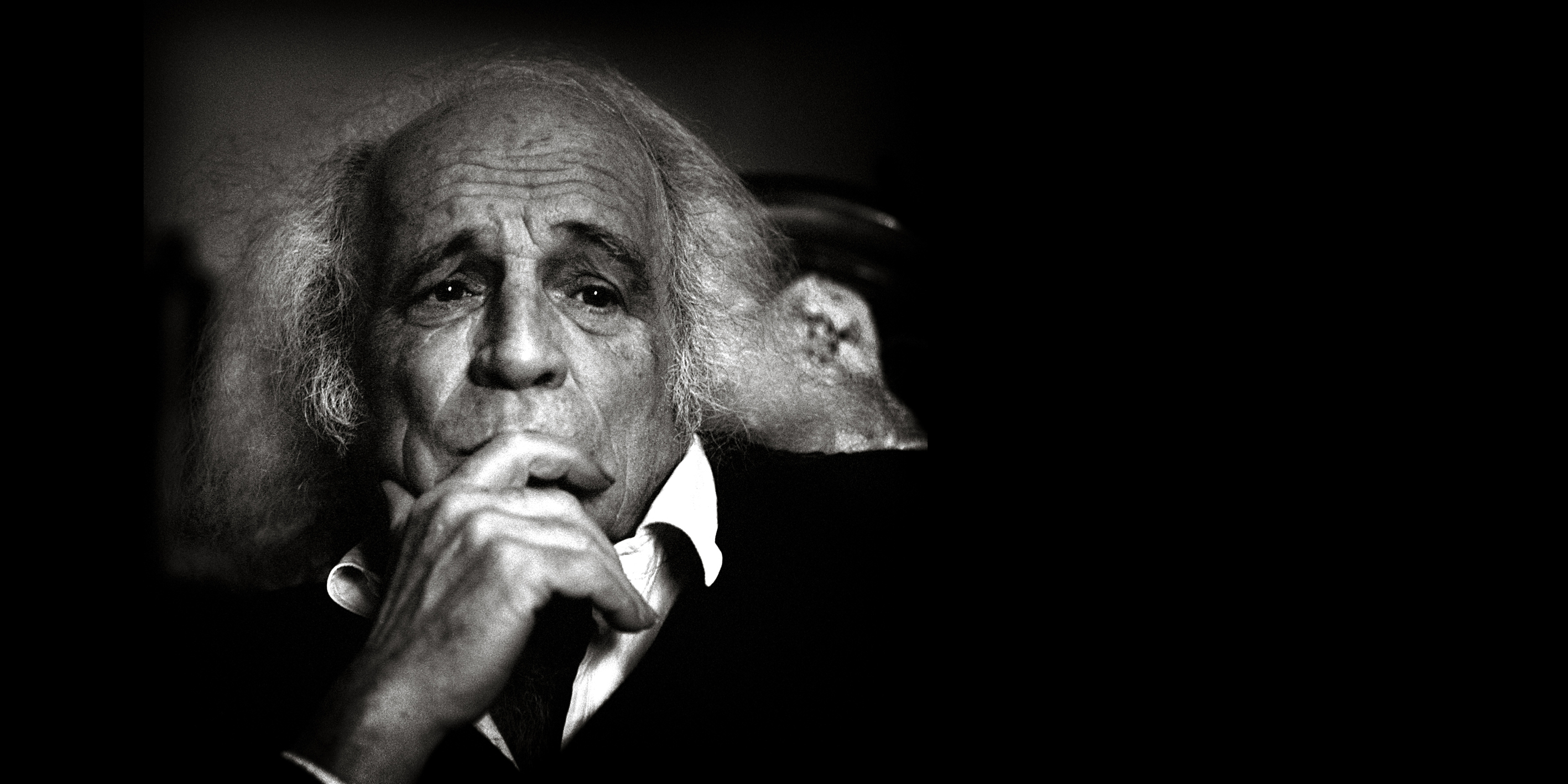ACTE I – LULU
1961. Pour l’heure, seul le calendrier indique que les années soixante ont débuté. Ni Dylan, ni les Beatles n’ont encore sorti d’album et les Américains ignorent que leur engagement progressif au Vietnam débouchera bientôt sur un traumatisme national. La grande peur du moment, c’est la guerre froide et sa course aux armements, un thème qu’Hollywood n’a d’ailleurs pas tardé à exploiter. Gregory Peck et Ava Gardner partagent l’affiche du Dernier rivage, l’histoire d’une poignée de rescapés d’un conflit atomique qui entretiennent le vain espoir de trouver d’autres survivants, pendant que petit à petit les radiations gagnent l’ensemble de la planète. Le film ne recueille qu’un succès mitigé, mais il marque l’esprit d’une jeune fille qui en parle avec ses amis tard dans la soirée. Elle a vingt ans, elle vient du Canada, et son nom c’est Bonnie.
Cette nuit-là, à Los Angeles, le sommeil ne lui venant pas, Bonnie Dobson imagine le dialogue funeste d’un couple au lendemain du cataclysme nucléaire. Les mots sont simples, la suite d’accords guère plus sophistiquée. Elle étrenne sa chanson en août, au festival de Mariposa, en Ontario, et publie l’année suivante un enregistrement public au tirage confidentiel, Live at Folk City, où on peut entendre sa voix jeune et cristalline déclarer: « This is a song about Morning Dew, and I hope that it never falls on us. » L’émotion est déjà présente, mais sans doute fallait-il avoir l’oreille d’un songwriter tel que Fred Neil pour déceler le potentiel de la composition.
Avec Vince Martin, en 1964, Fred Neil double la guitare acoustique d’une ligne de basse et accentue l’intensité dramatique du texte, qu’il retouche légèrement. Effort louable, mais pas encore de quoi faire passer la chanson à la postérité. Le pas décisif, c’est Tim Rose qui l’effectue deux ans plus tard. Il ajoute une batterie, passe la basse en surmultipliée et laisse exploser sa voix. Au passage, comme il l’avait déjà fait avec Hey Joe, il s’arroge un quart des droits d’auteur pour une soi-disant adaptation des paroles. Cavalier certes, mais pas tout à fait immérité, car à partir de là, Morning Dew ne va cesser de se faire entendre et reprendre, notamment par The Grateful Dead, le groupe emblématique de la scène hippie de San Francisco.
Au mois de juin 1967, Morning Dew déferle sur les îles britanniques en mode freakbeat. Procol Harum la joue en direct pour la BBC tandis que sort un 45 tours signé Episode Six, un groupe où figurent certains Ian Gillan et Roger Glover qui feront plus tard les beaux jours de Deep Purple. Six mois plus tard, cette aristocratie du rock pur et dur va pourtant être battue à plate couture par une gamine.
Lulu n’a que 19 ans, mais elle a de la bouteille. Elle chantait déjà dans les boîtes de Glasgow à l’époque où Bonnie Dobson fréquentait les cinémas de Los Angeles. Mickie Most, le grand faiseur de tubes du moment, produit la chanson; John Paul Jones, futur Led Zeppelin, est à la baguette. Mais qu’on ne s’y trompe pas, celle qui fait la différence, c’est la gamine qui déclare à la BBC: « I keep trying of a new way of describing this next song, but there really only is one way. And that is to say that the beauty of it lies in the simplicity of the lyrics. »
Manifestement, cette simplicité transcende ses interprètes. Quelle voix! Trois comme elle sur le mur d’Hadrien et jamais les Anglais ne se risquaient plus loin. Envoûtée par les sorcières de Macbeth, Lulu extrait Morning Dew des brumes des Highlands pour la faire culminer au firmament de la pop.
ACTE II – NAZARETH
En 1968, le déferlement continue. En Irlande avec Sugar Shack, en Nouvelle-Zélande avec The Avengers ou aux Pays-Bas avec The Whiskers, dont la version vaut le détour. En Italie, I Corvi modifient le titre en Questo è Giusto, tandis qu’en France, il devient Mama, Dis-moi pourquoi dans la bouche de Josiane Grizeau, qui a tout juste 20 ans et se fait appeler Séverine. La chanson continue bien sûr de faire école en Amérique. Nova Local passe Morning Dew au kaléidoscope et la ressort en mode psychédélique. Lee Hazlewood, le prolifique moustachu qui signe tous les tubes de Nancy Sinatra, lui apporte une subtile coloration country.
Cette année-là, cependant, le climat social se durcit, et la musique aussi. En mai, pendant que les étudiants hérissent des barricades dans les rues de Paris, une bande de gringalets fait deux brèves incursions dans les studios d’Abbey Road. Il en résultera Truth, un album qui va servir de modèle à Jimmy Page pour le premier Led Zeppelin, et qui sous bien des aspects lui demeure supérieur. Il faut dire que Jeff Beck est à la Stratocaster ce que Niccolò Paganini est au Stradivarius et qu’il y a là Ron Wood, qui finira sa carrière chez les Rolling Stones, Rod Stewart, qui hissera la croix de St Andrews au sommet des hit parades, ou encore Ken Scott, l’ingénieur à qui Bowie confiera le son de ses premiers albums. Origines écossaises du chanteur oblige, leur version de Morning Dew débute sur un air de cornemuse, le calme avant une bataille où la voix rauque de Stewart affronte les effets wah-wah déchaînés de Beck. Rarement l’expression «ça déchire» n’aura semblé plus appropriée.
Le clou, qui paraît pourtant bien planté, ne demande qu’à être enfoncé. La chanson revient en force dans l’histoire du rock en 1971, une nouvelle fois avec une version qui en a sous le kilt. Ni les critiques éclairés ni les fans du groupe écossais n’ont jamais fait grand cas du premier album de Nazareth, à tort! Plus dynamique qu’un Black Sabbath, plus lourd qu’un Led Zeppelin et plus propre qu’un Deep Purple, ce disque entrouvre les portes du heavy metal.
Un hymne folk étiré sur sept minutes et boosté aux amphétamines s’impose comme la pièce maîtresse de cette œuvre mégalithique. Oubliez Paranoïd, Whole Lotta Love ou Smoke on the Water, la chanson qui met le hard rock à genou se nomme Morning Dew.
ACTE III – BONNIE DOBSON
Comme un talisman protecteur, Morning Dew n’a cessé de marquer les débuts de carrière d’artistes précurseurs et de s’inscrire à l’avant-garde des courants musicaux. On retrouve la chanson en 1968 sur le premier Krokodil, un groupe qui aurait tout raflé dans la catégorie Krautrock s’il avait été allemand plutôt que zurichois. La version soul jazz que Selena Jones propose en 1970 n’a qu’un intérêt anecdotique, mais celle de Blue Mink de 1972, dans un genre qu’on qualifierait aujourd’hui de breakbeat, est très en avance sur son temps. En 1987, alors que le rock industriel est en plein essor, le grunge fait ses premiers pas. Cette année-là, deux nouvelles versions de Morning Dew voient le jour, celle des Berlinois d’Einstürzende Neubauten et celle des Screaming Trees, un groupe de la côte nord-ouest emmené par Mark Lanegan. Devo leur emboîte le pas en 1990 avec une décevante version électro (à l’impossible nul n’est tenu).
En 2002, c’est dans un style plus classique que Robert Plant ajoute Morning Dew à son répertoire. Dans un concert, en 2015, il raconte sa surprise lorsqu’il a rencontré son auteure dans les années soixante. « I was totally unaware that this spectacular piece of music had been written by the great […] Bonnie Dobson », dit-il en l’invitant sur scène pour un duo. La classe, ça ne s’invente pas.
L’adoubement par les plus grands, Bonnie Dobson ne devrait pourtant pas en avoir besoin. Elle avait fini, en 1969, par enregistrer sa propre version studio. C’était ce qui s’appelle remettre l’église au milieu du village. Sa chanson ne doit rien à personne, pas plus que sa voix n’a à envier quoi que ce soit à quiconque. Morning Dew, de et par Bonnie Dobson, est aussi, et peut-être avant tout, un monument du folk.
https://www.youtube.com/watch?v=GOSoaUTMG2o