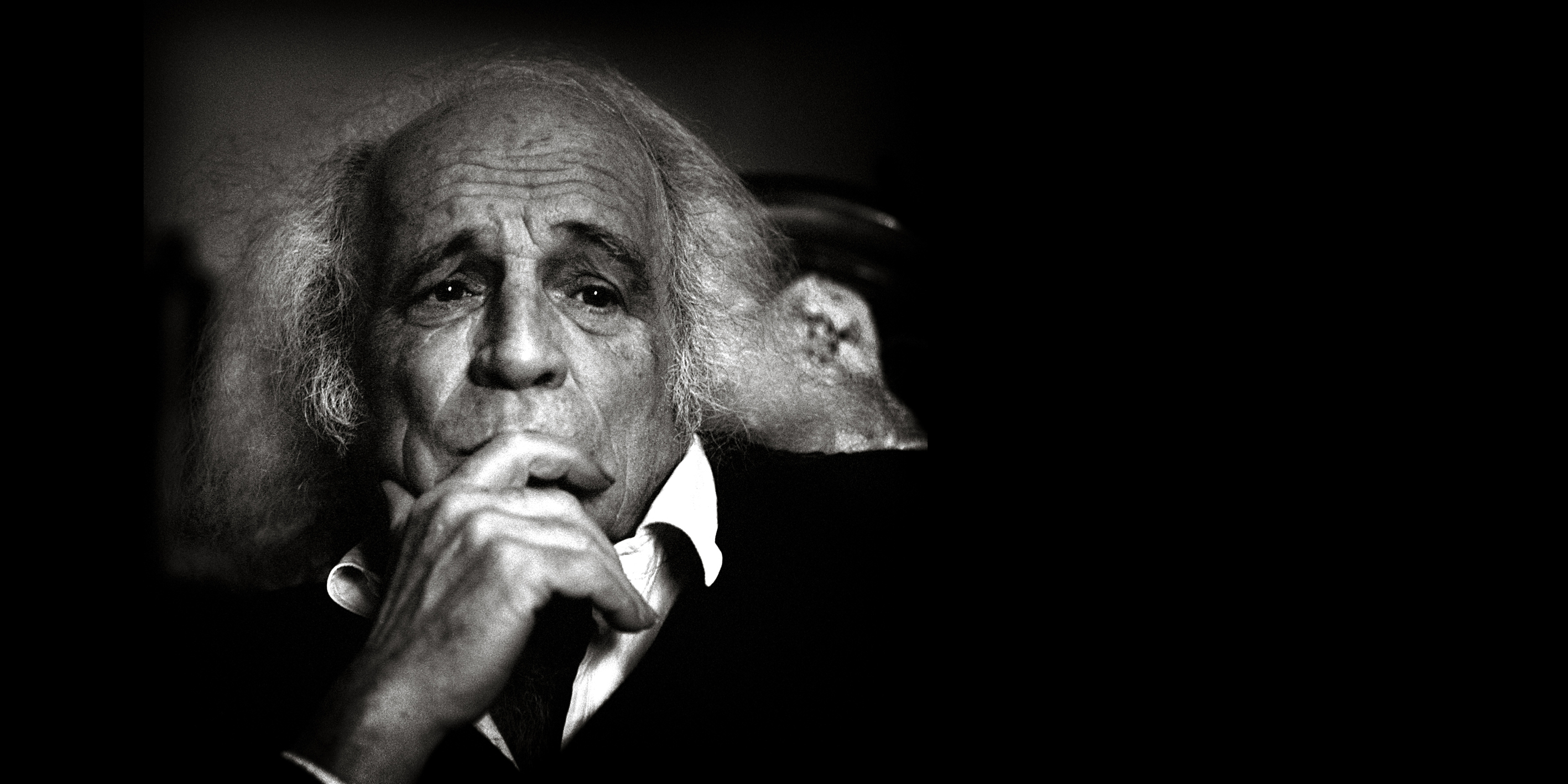Il est des chansons qui nous accompagnent notre vie durant. Ce sont le plus souvent des chansons à texte ou même des chants religieux, dont le pouvoir d’envoûtement demeure intact après des décennies d’odyssée. Elles ne sont pas éternelles, elles sont actuelles ; c’est-à-dire qu’elles s’inscrivent dans un perpétuel présent. D’où sans doute leur incomparable puissance. Il serait faux de penser que nous réécoutons ces chansons, parce que ce sont plutôt elles qui nous écoutent, et qu’une année sans leur rendre visite est une année perdue. Je songe ici aux paroles des fortes chansons qui nous ont accompagnés.
Nous n’aimerions pas, à leur propos, parler aujourd’hui de parenté de sang, mais ces chansons où joue le moi d’une façon inégalable finissent par se mêler si intimement avec ce moi qu’on n’est plus trop certain de pouvoir décider, entre elles et nous, qui est le vrai porteur de l’identité. On sait étonnement vite quelle est pour nous la chanson idéale, et cette connaissance n’est pas fondée sur une connaissance de soi (toujours lacunaire, il faut bien l’admettre) mais sur le fait, autrement plus profond, qu’une chanson et une personnalité sont indissolublement liés. Il serait erroné d’imaginer que cette union provienne uniquement d’un sentiment partagé. Non, il faut chercher la cause de cette attraction ailleurs que dans une communion affective. Nous deux, de Ferré semble aller au-delà d’un seul amour réciproque.
Je crois que le propre de ce phénomène réside dans le fait qu’une véritable œuvre implique d’autres œuvres. Telle chanson de Brel en appelle une autre, de Ferré, de Barbara, de Brassens et, comme une sorte de mille-feuilles dont chaque étage entre en résonance avec d’autres étages, elle nous transporte aux différents degrés de nous-mêmes. Tant et si bien que la complexité des textes mise en réseau trouve un répondant dans la complexité des âmes et de leurs désirs. C’est ainsi que les hommes vivent ! Et leurs baisers au loin les suivent.
Ainsi, au moment où nous habite ce phénomène de résonance, une sorte de vague intérieure nous emporte et on reste là, debout face à la mer, à écouter les voix intérieures alors que la lumière prend la couleur de l’étain. Un vent frais vous fouette le visage avec des odeurs de nuit ; on entre dans un bar, on commande un bock de bière, et on regarde loin derrière la glace du comptoir, tandis que les paroles de Ferré se lèvent en nous :
Un port du Nord, ça plaît
Surtout quand on n’y est pas.
Ça fait qu’on voudrait y être
Ça fait qu’on n’sait pas bien
S’il faut s’taper le poète
Ou s’taper la putain.